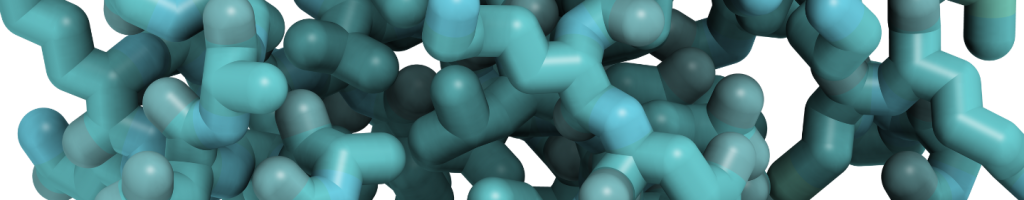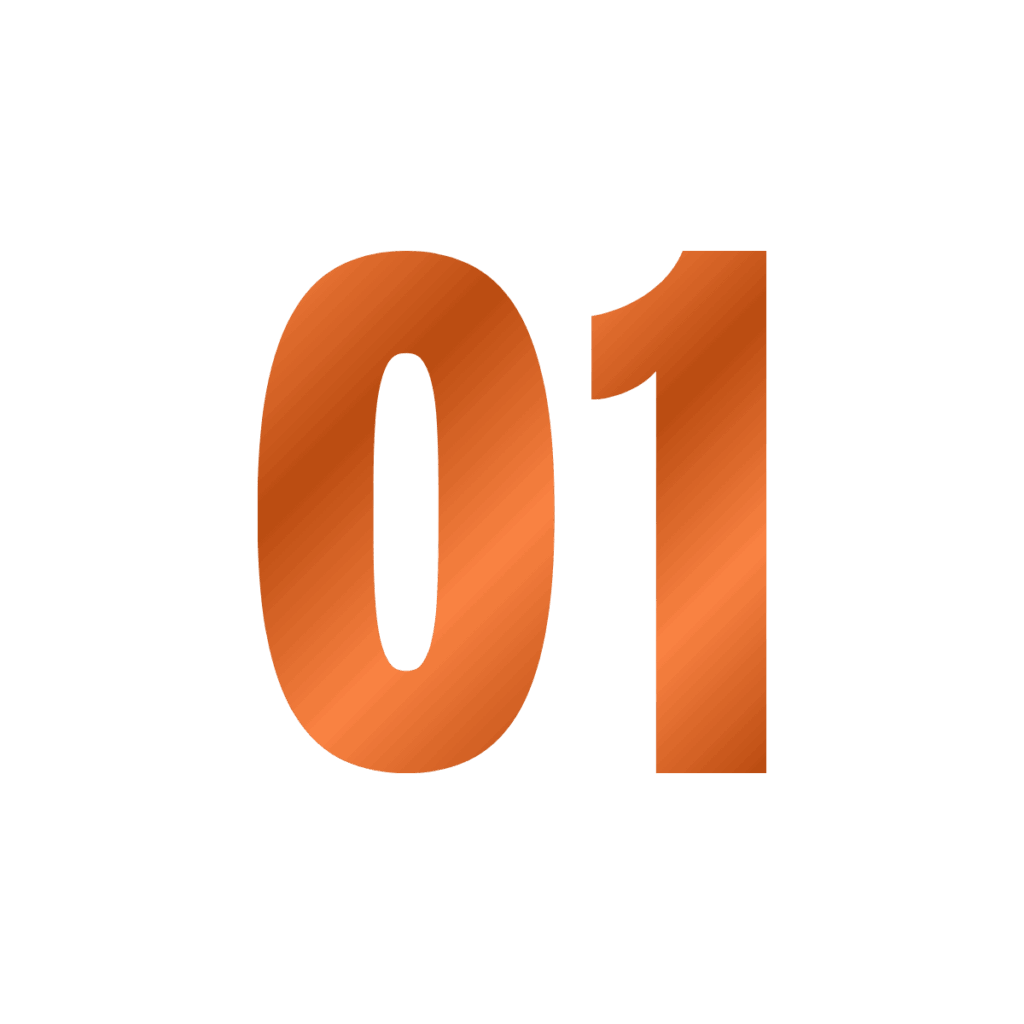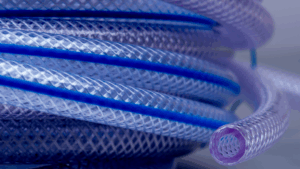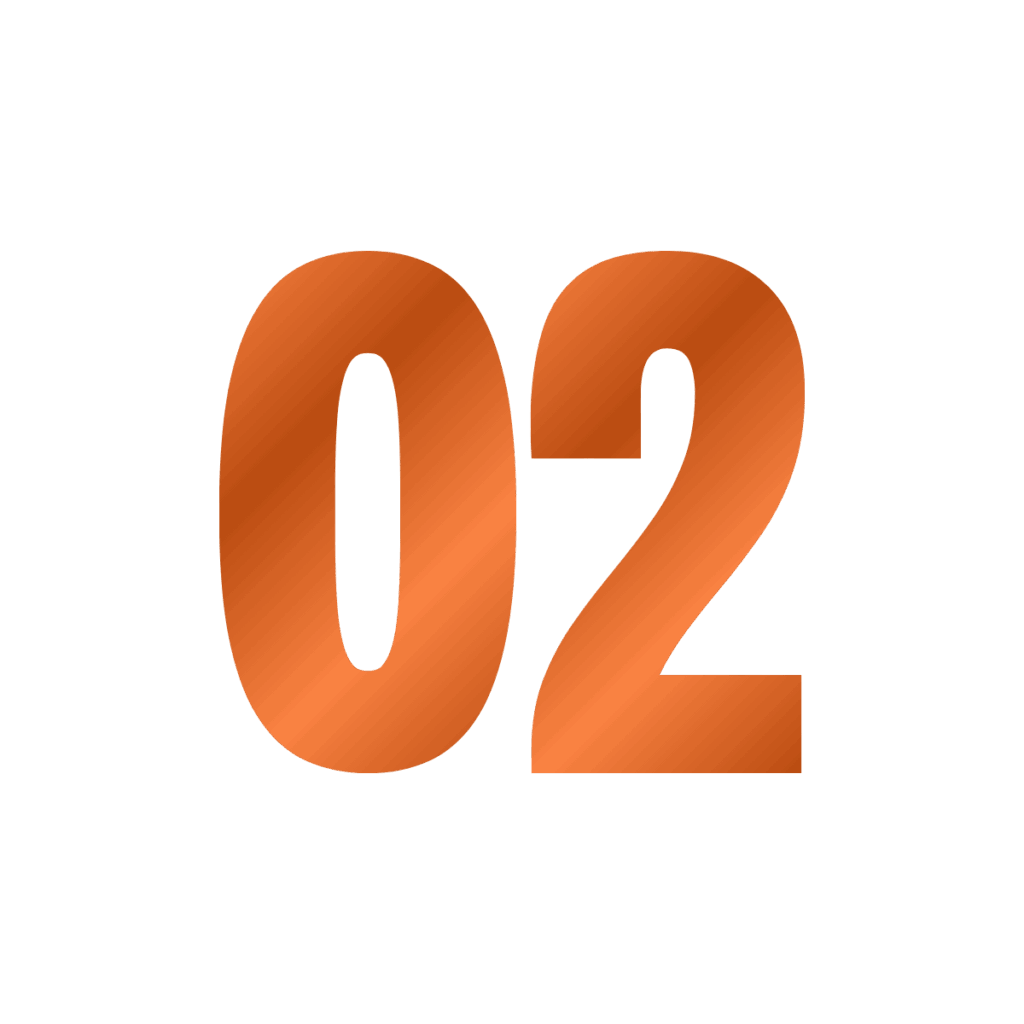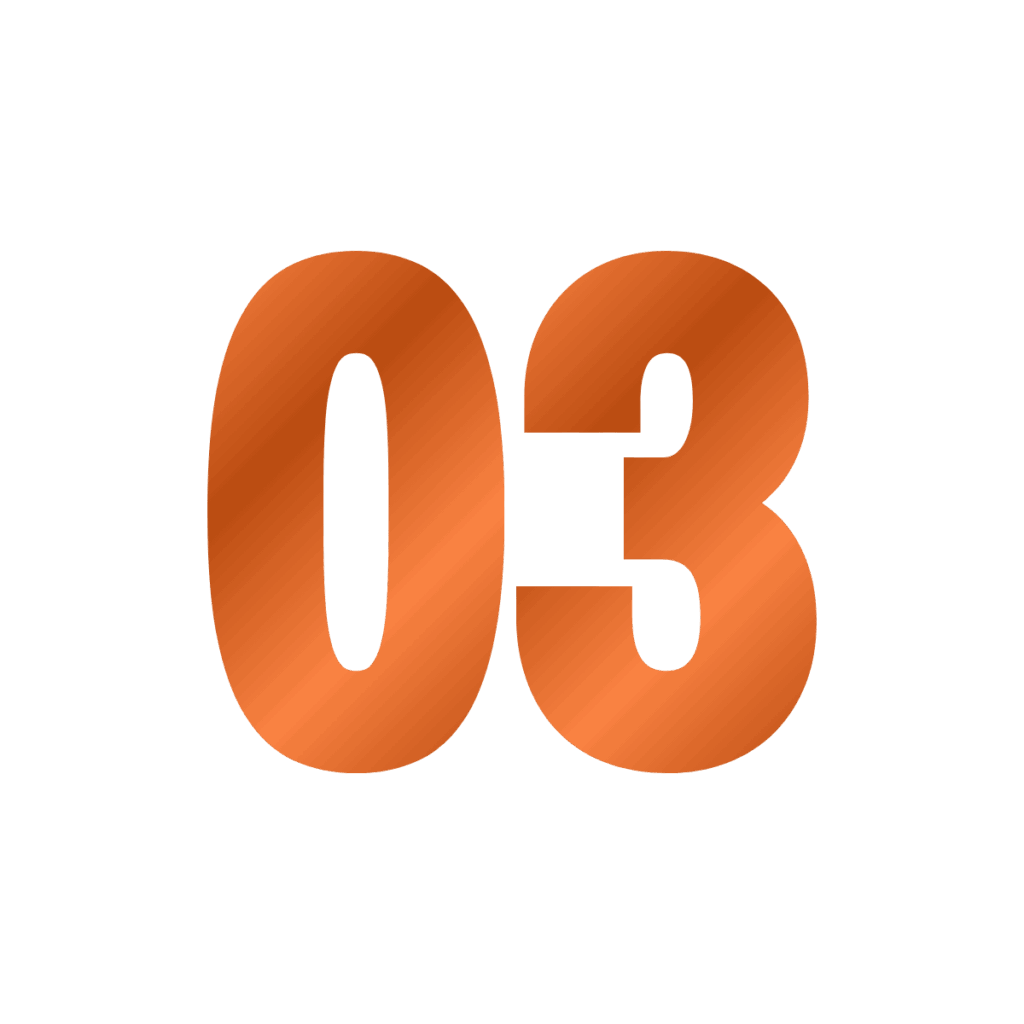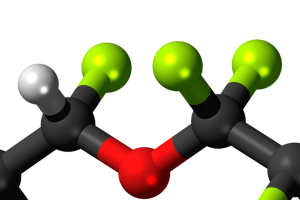Laboratoire d’analyses et d’expertises spécialisé pour les industriels
+140 collaborateurs
à votre écoute
5200 m² de laboratoire
+ 99% des prestations sont réalisées en interne
Laboratoire accrédité
COFRAC ISO 17025
+2200 clients
en France et à l'étranger